Vous avez consulté 1 fiches sur 543
Ce site utilise un cookie pour mémoriser votre parcours pendant 90 jours – pour l'effacer, cliquez ci-dessous sur réinitialiser votre session
réinitialiser votre session
Menu > Musées > Fort Boquerón

Cette fiche
n'est pas dans
votre itinéraire –
ajoutez-la
 Fort Boquerón
Fort Boquerón
au beau milieu de l'implacable Chaco Seco, les vestiges de ce fort témoignent d'un des épisodes les plus meurtriers de la Guerre du Chaco, qui opposa Bolivie et Paraguay pour la possession de ce désert inculte ; un siège au cours duquel la soif fit davantage de victimes que les obus. Munissez-vous d'une gourde.
 Quelques précisions
Quelques précisions
Quelques mots à propos de la
Guerre du Chaco. D'aucun se demanderaient certainement ce qui a bien pu pousser la Bolivie et le Paraguay à engager un demi-million de conscrits pour conquérir ce vaste désert peuplé de quelques tribus indigènes et d'une poignée de
Mennonites : le Chaco boréal, qui aujourd'hui encore offre un aspect aride et vaguement monotone, celui de l'écosystème du
chaco seco, auquel seuls zoologues, botanistes et quelques touristes aventureux peuvent trouver un certain intérêt.
Au début du XXème siècle, la souveraineté sur cette portion boréale du Chaco (qui par ailleurs s'étend plus au sud jusqu'à Córdoba) n'avait jamais été très clairement définie, et reposait surtout sur de vagues prétentions territoriales de la part de ses riverains : Bolivie (à l'ouest), Paraguay (à l'est), mais aussi Argentine (au sud) et Brésil (au nord). Le Paraguay avait initié dans les années 20 une phase de colonisation du Chaco, grâce à l'immigration d'un contingent de Mennonites venus du Canada, mais sans autre ambition que d'occuper “au cas où” ce vaste territoire qui, à tout le moins, permettait de doubler la superficie du Paraguay.
Mais des enjeux économiques ne tardèrent pas à aviver la gourmandise des Boliviens. Ces derniers, d'une part, étaient privés d'un accès à l'Océan Pacifique depuis leur défaite face aux Chiliens, en 1879 – annexer le Chaco jusqu'au
fleuve Paraguay, qui délimite le Chaco à l'est, permettrait donc de se dédommager avec un accès fluvial à l'Océan Atlantique. Et d'autre part, la course au pétrole commençait à faire ses ravages.
La Standard Oil exploitait en effet quelques gisements d'hydrocarbures dans la province bolivienne de
Santa Cruz, frange occidentale du Chaco, et supposait que ces gisements devaient pareillement s'étendre sous l'ensemble du Chaco. Une telle rumeur ne tarda d'ailleurs pas à arriver aux oreilles du gouvernement paraguayen, aussitôt incité par la Royal Dutch Shell à faire valoir sa souveraineté sur le Chaco. Ainsi se déclencha en 1932 un conflit pétrolier anglo-hollandais par États sud-américains interposés...
Cette guerre particulièrement meurtrière fit une centaine de milliers de morts. Outre la violence de ponctuels affrontements, qui venaient rompre l'enfer d'une guerre de position campée sur ses tranchées, la soif fut l'une des principales faucheuses de vies humaines. Le siège de Fortín Boquerón en fut le paroxysme.
La Guerre du Chaco, qui reste le conflit militaire majeur du XXème siècle en Amérique Latine, se solda par la défaite de la Bolivie, en 1935. Les deux ennemis étaient à genoux, et le Chaco ne révéla pas la moindre goutte de pétrole.



 Infos pratiques
Infos pratiques
Carnets associés

Retrouvez également les photos de cette fiche sur notre carte :
Les fiches thématiques sans ancrage local particulier ne sont pas épinglées sur la carte.
| LÉGENDE |
 Provinces Provinces |  Confins Confins |
 Carnets Carnets |  Réserves Réserves |
 Héritages Héritages |  Dévotions Dévotions |
 Archéologie Archéologie |  Massifs Massifs |
 Vallées Vallées |  Écosystèmes Écosystèmes |
 Botanique Botanique |  Zoologie Zoologie |
 Ornithologie Ornithologie |  Pasos Pasos |
 Cuestas Cuestas |  H2O H2O |
 Gastronomie Gastronomie |  Temples Temples |
 Mines Mines |  Industrie Industrie |
 Trek & Cie. Trek & Cie. |  Parcours Parcours |
 Musées Musées |  Thermes Thermes |
 Villes Villes |  Photos Photos |
|
|
   bientôt disponible bientôt disponible |


 Cette fiche n'est pas dans
Cette fiche n'est pas dans
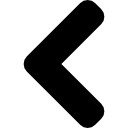
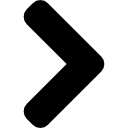
 photo 1/5 – Monument boliviano-paraguayen pour la paix
photo 1/5 – Monument boliviano-paraguayen pour la paix


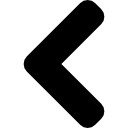
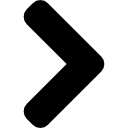
 photo 3/5 – Racine de yvy'a, gorgée d'eau, devant la tuca du commandant bolivien
photo 3/5 – Racine de yvy'a, gorgée d'eau, devant la tuca du commandant bolivien

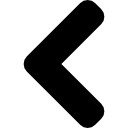
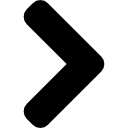
 photo 4/5 – Le musée, un rien poussiéreux, propose de nombreux clichés d'époque
photo 4/5 – Le musée, un rien poussiéreux, propose de nombreux clichés d'époque

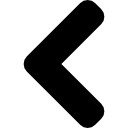
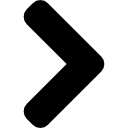
 photo 5/5 – Crépuscule fantomatique
photo 5/5 – Crépuscule fantomatique







 Quelques précisions
Quelques précisions


 Infos pratiques
Infos pratiques Provinces
Provinces Confins
Confins Carnets
Carnets Réserves
Réserves Héritages
Héritages Dévotions
Dévotions Archéologie
Archéologie Massifs
Massifs Vallées
Vallées Écosystèmes
Écosystèmes Botanique
Botanique Zoologie
Zoologie Ornithologie
Ornithologie Pasos
Pasos Cuestas
Cuestas H2O
H2O Gastronomie
Gastronomie Temples
Temples Mines
Mines Industrie
Industrie Trek & Cie.
Trek & Cie. Parcours
Parcours Musées
Musées Thermes
Thermes Villes
Villes Photos
Photos

 bientôt disponible
bientôt disponible