Ce site utilise un cookie pour mémoriser votre parcours pendant 90 jours – pour l'effacer, cliquez ci-dessous sur réinitialiser votre session
 Quelques précisions
Quelques précisions
Le terme “desaparecido”, que l'on traduira par “disparu”, n'est pas ici un synonyme de décédé, euphémisme chéri des pudibondes rubriques nécrologiques ; il faut le prendre au pied de la lettre, comme l'a si parfaitement, cyniquement et cruellement rappelé le plus zélé de ses promoteurs : Jorge Videla, chef de la junte militaire qui l'a conduit à la présidence de facto de l'Argentine de 1976 à 1981, et aujourd'hui incarcéré pour Crime contre l'Humanité. Voici la définition qu'il en donna :
« Qu'est-ce qu'un disparu ? En tant que tel, le disparu est une inconnue. S'il réapparaissait, il aurait un traitement X, et si la disparition se convertissait en décès, il aurait un traitement Z. Mais tant qu'il est disparu, il ne saurait avoir aucun traitement particulier, c'est une inconnue, c'est un disparu, il n'a pas d'entité, il n'est ni mort ni vivant – il est disparu ».
Guérilla et dictature : les racines d'un drame national
Après la théorie, la pratique. Cette politique de disparition des opposants (car c'est de cette catégorie d'individus dont il s'agit, on l'aura compris) a été mise en place dans de nombreux pays d'Amérique du Sud dans les années 70 et 80, et synchronisée dans le cadre de l'Opération Condor chapeautée par la CIA. Son objectif était de mettre un terme aux nombreux mouvements de guérilla marxiste, rurale ou urbaine, sévissant en Argentine, au Chili, au Brésil, en Uruguay, en Bolivie, et de façon plus sporadique dans la plupart des autres pays du continent. Ces mouvements, il est vrai, prenaient une ampleur telle que les instances gouvernementales démocratiques ne parvenaient plus à les endiguer.
La solution d'un coup d'État militaire et d'une répression dictatoriale (communément appelée terrorisme d'État) a donc remporté de vifs soutiens auprès de larges pans de la société, même si certains seraient tentés aujourd'hui de l'oublier... Ainsi parvinrent au pouvoir, sans rencontrer beaucoup d'opposition, un Pinochet au Chili, un Bordaberry en Uruguay, un Banzer en Bolivie, un Castelo Branco au Brésil – Stroessner muselait le Paraguay depuis les années 50. D'autres noms, bien sûr, trempèrent dans cette coalition des dictatures. Quant à l'Argentine, c'est donc le général Jorge Videla et sa junte militaire, comme nous l'avons évoqué plus haut, qui renversèrent en 1976 ce qu'il restait de démocratie – après plusieurs décennies de péronisme entrecoupé d'éphémères dictatures militaires, cette dernière semblait attendre le coup de grâce.
Sitôt au pouvoir, Videla et sa clique initièrent le tristement célèbre
Processus de Réorganisation Nationale, plus connu comme
el Proceso, qui se donnait pour tâche de mater définitivement les guérillas, présentes et à venir. Aussi, tandis que sur le terrain strictement militaire (et à peu près légal) on tâchait de venir à bout des maquisards embusqués dans les
Yungas de la province de Tucumán, on entreprit parallèlement une chasse aux opposants civils, déclarés ou potentiels, avec une prédilection pour la jeunesse – opérations de nettoyage absolument illégales, et donc tenues secrètes dans la mesure du possible. Pour ce faire, la “disparition” systématique de personnes fut retenue comme une alternative plus satisfaisante aux encombrants camps de concentration (solution toutefois retenue par Pinochet au Chili, qui réquisitionna à cet effet plusieurs stades de football).
Le terrorisme d'État
Faire “disparaître” un individu consistait à enlever la cible avec une discrétion dont les ravisseurs ne s'encombraient que rarement, assurés de leur impunité. En civil ou en uniforme, ils mettaient la main sur leur victime chez elle, ou en pleine rue, au nez et à la barbe des familles ou des passants. Le captif était alors emmené dans un endroit qui, lui, était tenu secret : un CCD, ou Centre Clandestin de Détention; on en a recensé a posteriori plusieurs centaines, disséminés dans tout le pays, avec une prédilection pour les provinces les plus urbanisées : Córdoba, Santa Fe (Rosario) et Buenos Aires.
Le plus fameux de ces CCD fut l'École Supérieure de Mécanique de la Marine, sise dans un recoin discret du périphérique de Buenos Aires – entre ses murs passèrent plus de 5.000 détenus. Ces centres étaient bien entendu davantage dédiés à la torture qu'à la seule détention, l'objectif n'étant pas tant de faire avouer le séquestré (sa culpabilité ne faisant aucun doute aux yeux des tortionnaires, et sa relaxation – sa “réapparition” – ne pouvant pas être envisageable) que d'obtenir le nom d'autres complices potentiels (sinon déclarés) de son entourage familial ou universitaire. On démantela ainsi de longues filières de futurs coupables et d'innocents caractérisés.
La dernière étape du
traitement réservé aux prisonniers était enfin la “disparition” pure et simple. Preuve de son efficacité, on n'a jamais retrouvé que quelques corps (mutilés), échoués sur les rives du
Río de la Plata. Il est aujourd'hui attesté que la méthode de disparition finale réservée par les militaires aux locataires des CCD consistait à les larguer par avion au beau milieu du grand estuaire, pieds et poings liés. Une méthode atterrante, à la mesure de la barbarie des despotes. Ainsi disparurent, sans laisser de trace, plus de
30.000 personnes.
Jusqu'à quel degré la société argentine toute entière fut-elle impliquée dans ce drame ? Il est indéniable que les méthodes des tortionnaires, clandestines et tenues secrètes, ne furent pas d'emblée connues de l'opinion publique, plutôt encline dans un premier temps à plébisciter le retour à l'ordre – à ce titre, nombres de partis politiques et de médias consentirent à donner carte blanche à la junte. Mais les enlèvements ne passaient pas inaperçus, et la disparition des victimes créait un vide qui à la longue devint un gouffre et au final fut loin de demeurer une « inconnue », n'en déplaise aux belles théories de Videla.
Stopper l'engrenage infernal
Aussi, avec le temps, quelques organisations protestataires virent le jour et donnèrent de la voix. La principale d'entre elles la constituèrent de nombreuses mères de desaparecidos, qui prirent l'habitude de se regrouper chaque jeudi Plaza de Mayo, à Buenos Aires, sous les fenêtres du Palais présidentiel, pour réclamer la vérité sur les enlèvements. Ces Madres de Plaza de Mayo (Mères de la Place de Mai), bien qu'on puisse penser que leur qualité de mère leur ait conféré l'immunité, eurent à souffrir elles-aussi de la répression – ainsi les trois fondatrices de l'association moururent-elles aux mains des tortionnaires ; nous citons leur nom en hommage à tous ceux et celles de leurs enfants et des enfants de leurs compagnonnes qui moururent comme elles : Azucena Villaflor, Esther Ballestrino et María Ponce. Elles avaient entre 53 et 59 ans.
L'action des Madres de Plaza de Mayo, soutenue par de plus en plus d'opposants déclarés, devait trouver sa consécration finale avec la Guerre des
Malouines qui, en 1982, emporta dans la débâcle la junte militaire qui l'avait déclenchée pour reconquérir les cœurs d'une opinion publique désabusée – en vain. Avec le retour de la démocratie en 1983, on sortait enfin de la Terreur. Allait-on pour autant retrouver les victimes et punir les coupables ?
Le sort des premiers était hélas scellé depuis longtemps – on a déjà dit que leur disparition n'était pas un euphémisme, bien que certains aient soutenu qu'ils pouvaient être détenus dans quelque base secrète de Patagonie ou d'ailleurs... Quant aux seconds, ils connurent un sort riche en rebondissements, ponctué de condamnations à perpétuité, d'amnistie, d'assignation à résidence – à l'heure actuelle, un nouveau procès a renouvelé la condamnation à la réclusion à perpétuité, en décembre 2010. A l'issue du jugement, Videla, âgé de 85 ans, a déclaré assumer intégralement toute la responsabilité de son gouvernement ; il dort désormais en prison, avec ses acolytes.
Traumatisme post-dictatorial : enfants volés et quête d'identité
Entre-temps (et c'est le dernier aspect, crucial, de cette tragédie), les Madres de Plaza de Mayo sont devenues grands-mères, et le combat des Abuelas de Plaza de Mayo a pris une tout autre tournure, non moins éprouvante. Si le sort des criminels enfin condamnés pourrait laisser penser que le drame est terminé, le cas des enfants des desaparecidos a ouvert de nouvelles perspectives, abyssales.
Car il faut bien garder à l'esprit que cette jeunesse fauchée par les militaires était en âge de procréer et n'avait eu aucune raison de s'en priver. Aussi, tandis qu'on les séquestrait et qu'on les torturait, de nombreuses jeunes femmes accouchèrent, dans des conditions que l'on imagine abominables. Ces enfants nés en captivité, qui plus est dans une clandestinité d'État, furent aussitôt séparés de leur mère et confiés aux familles des bourreaux – qu'il s'agisse des “simples” tortionnaire ou des plus hauts collaborateurs du régime. Ceux-ci, loin d'en faire des Cendrillons, élevèrent et chérirent ces enfants avec cette affection que même les pires criminels peuvent évidemment éprouver.
Mais à la chute de la dictature, et grâce notamment au labeur des Madres de Plaza de Mayo, l'ampleur du phénomène éclata au grand jour : un nombre difficilement calculable d'enfants n'avaient pas pour parents ceux qui se prétendaient comme tels. Les Madres, devenues Abuelas, entreprirent alors de retrouver ces enfants, leurs propres petits-enfants, en questionnant systématiquement les familles convaincues ou suspectées de collaboration avec la junte, en sensibilisant l'opinion nationale, et surtout en appelant une génération entière d'enfants devenus entre-temps adolescents puis jeunes adultes (certains ont aujourd'hui la trentaine) à s'interroger sur leur naissance et sur leur identité. Il s'en est suivi une vague de drames familiaux, abondamment médiatisés, éclaboussant régulièrement les hautes sphères de la politique ou du monde des affaires.
Cependant, la rancœur et la vengeance ne sont pas toujours les sentiments que ces enfants retrouvés vouent à leurs parents adoptifs – on peut les comprendre. Il en résulte des situations extrêmement traumatisantes. Aujourd'hui les Abuelas, au crépuscule de leur vie endeuillée, mettent les bouchées doubles pour retrouver les derniers enfants-perdus, dans une lutte que certains considèrent comme trop acharnée mais dont maintes associations prennent la relève, soutenues par les gouvernements de Nestor puis Cristina Kirchner (qui ont avec les Abuelas un de leurs plus indéfectibles soutiens politiques). La société argentine est tout entière accablée par cette authentique tragédie grecque, où la notion de justice n'équivaut jamais à celle du bonheur et de la paix...
Il est un film qui résume excellemment cette sombre période de l'histoire argentine, et dont le succès ne s'est jamais démenti : La historia oficial (L'histoire officielle), paru en 1985.
Depuis 2002, le 24 mars, jour anniversaire du coup d'État de 1976, a été décrété Jour férié National de la Mémoire pour la Vérité et la Justice.
Les fiches thématiques sans ancrage local particulier ne sont pas épinglées sur la carte.





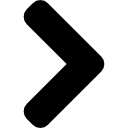
 photo 2/9 – Les noms des Desaparecidos cordobais, sur le mur de l'ex-CCD
photo 2/9 – Les noms des Desaparecidos cordobais, sur le mur de l'ex-CCD


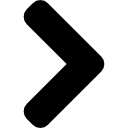
 photo 3/9 – Nunca más (“jamais plus”), rétrospective macabre près de l'ex-CDD de Córdoba
photo 3/9 – Nunca más (“jamais plus”), rétrospective macabre près de l'ex-CDD de Córdoba


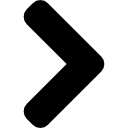
 photo 4/9 – Les instigateurs du Proceso sont derrière les barreaux
photo 4/9 – Les instigateurs du Proceso sont derrière les barreaux


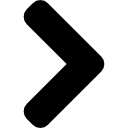
 photo 5/9 – Une affiche commémorant les 40 ans du début de la dictature (1976-2016)
photo 5/9 – Une affiche commémorant les 40 ans du début de la dictature (1976-2016)

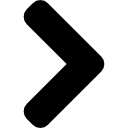
 photo 6/9 – Plaza de Mayo, Buenos Aires : haut-lieu historique et actuel de l'action des Abuelas
photo 6/9 – Plaza de Mayo, Buenos Aires : haut-lieu historique et actuel de l'action des Abuelas

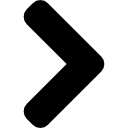
 photo 7/9 – Les Abuelas à la recherche des enfants volés – ici à Santa Rosa (La Pampa)
photo 7/9 – Les Abuelas à la recherche des enfants volés – ici à Santa Rosa (La Pampa)

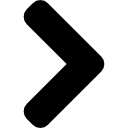
 photo 8/9 – Slogan récurrent des innombrables mémoriaux, ici près d'El Calafate (Santa Cruz)
photo 8/9 – Slogan récurrent des innombrables mémoriaux, ici près d'El Calafate (Santa Cruz)

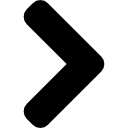
 photo 9/9 – Sensibilisation sur les rabats d'une boîte-repas de la compagnie aérienne Aerolíneas Argentinas
photo 9/9 – Sensibilisation sur les rabats d'une boîte-repas de la compagnie aérienne Aerolíneas Argentinas

 Quelques précisions
Quelques précisions Provinces
Provinces Confins
Confins Carnets
Carnets Réserves
Réserves Héritages
Héritages Dévotions
Dévotions Archéologie
Archéologie Massifs
Massifs Vallées
Vallées Écosystèmes
Écosystèmes Botanique
Botanique Zoologie
Zoologie Ornithologie
Ornithologie Pasos
Pasos Cuestas
Cuestas H2O
H2O Gastronomie
Gastronomie Temples
Temples Mines
Mines Industrie
Industrie Trek & Cie.
Trek & Cie. Parcours
Parcours Musées
Musées Thermes
Thermes Villes
Villes Photos
Photos

 bientôt disponible
bientôt disponible