Ce site utilise un cookie pour mémoriser votre parcours pendant 90 jours – pour l'effacer, cliquez ci-dessous sur réinitialiser votre session
 Quelques précisions
Quelques précisions
Lorsque ce même voyageur sort de l'aéroport domestique de Buenos Aires et déboule sur la Costanera Rafael Obligado, il peinera sans doute à se convaincre qu'il a devant ses yeux la rive d'un simple fleuve, tant l'immense masse d'eau qui s'offre à lui a tout l'air d'une mer – voire de l'Atlantique. Et pourtant, il s'agit bien d'un fleuve, ou plutôt de l'estuaire d'un fleuve, et même de deux.
Considérations géographiques
Le Río de la Plata naît en effet de la confluence des ríos
Paraná et
Uruguay, qui drainent un immense bassin de plus de trois millions de mètres carrés (second bassin hydrographique d’Amérique Latine en terme de surface de captation, après l’Amazone), dont la périphérie porte aussi loin que les hauteurs de Rio de Janeiro, le Pantanal brésilien ou les parages de
Sucre et
Potosí en Bolivie. En Argentine, son bassin englobe jusqu'à l'est de Salta et les confins patagons de la pampa, en excluant toutefois une bonne part de la région intermédiaire et endoréique de Córdoba. Complétons ce tableau hydrographique en citant quelques-uns de ses principaux tributaires : le
Pilcomayo, le Bermejo, le
Paraguay, le Salado ou encore l'
Iguazú.
Au moment où ce flot diluvien achève son périple, peu en amont de Buenos Aires, la masse titanesque de limon qu'il charrie se dépose massivement et forme le
Delta ; ce réseau labyrinthique de canaux et d'arroyos, recouvert d'une végétation inextricable, s'ouvre brusquement à l'est sur l'estuaire du Río de la Plata, vaste étendue d'eaux légèrement brunâtres dont les dimensions en font le plus grand estuaire du monde. Sur 290km de long, il s'évase jusqu'à atteindre 219km de large à son extrémité orientale.
Cette dernière se dessine clairement sur une photographie satellite : de part et d'autre d'une ligne tirée entre Punta del Este (au nord, en Uruguay) et
Punta Rasa (au sud, en Argentine), la couleur de l'eau change radicalement. Le limon brunâtre se dissout dans le bleu profond de l'Atlantique. L'influence de l'océan se fait d'ailleurs sentir dans l'estuaire et jusque dans le Delta, où la marée opère un gonflement du fleuve deux fois par jour. La salinité cependant ne pénètre que faiblement l'estuaire, jusqu'à hauteur de Montevideo
grosso modo.
Mais pourquoi ce mastodonte limoneux porte-t-il le nom si poétique de Fleuve de l'Argent ?
Exploration et cupidité
Le grand moteur de la conquête hispanique des Amériques a été l'appât des métaux précieux. Christophe Colomb le premier ne se risqua à franchir l'Atlantique que dans l'espoir (déçu) d'atteindre les richesses mythique de Cipango, un Japon gorgé d'or et fantasmé. A sa suite, les conquistadores entreprirent de dénicher la source des richesses exhibées par les indigènes des Caraïbes ou du Panamá. Un fatras de légendes et de rumeurs colportées, peut-être à dessein, par les indigènes désireux d'éloigner les trouble-fêtes, enivrèrent les conquérants, qui n'eurent de cesse d'atteindre de mirifiques contrées où tout était d'or ou d'argent.
Ainsi naquirent deux grands mythes qui canalisèrent la conquête du Nouveau Monde : côté Caraïbe-Pacifique, El Dorado (Le Doré) précipita les Quesada, Belalcázar et Federmán dans les jungles colombiennes, et les Pizarro et Almagro à l'assaut de la cordillère péruvienne, à la recherche d'un royaume croulant sous les lingots. Côté Atlantique, ce fut le Rey Blanco (Roi Blanc), souverain couvert d'argent, qui éveilla la rapacité la plus folle.
L'exploration du littoral atlantique de l'Amérique du Sud fut menée par quatre grands navigateurs. Le premier d'entre eux fut Amerigo Vespucci, qui parvient vraisemblablement jusqu'au littoral de Santa Cruz, en Patagonie, et même sans doute aux Malouines, en 1501 – des cosmographes vosgiens donneront son prénom à l'Amérique. Le second fut Juan Díaz de Solís qui pénètra dans le Río de la Plata en 1516 ; débarqué à Punta Gorda sur le littoral uruguayen, il y fut victime d'une attaque indigène ; pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, on baptisa l'estuaire Río de Solís en son honneur.
En 1520, c'est
Magellan qui croise au large de l'estuaire. Mais, pourchassant de plus grands rêves encore, il passe son chemin et poursuit sa route le long du littoral atlantique, vers la Patagonie et bien plus loin encore...
En 1525 surgit un quatrième explorateur,
Sebastián Caboto (né Sebastiano Caboto à Venise ; également connu sous son nom francisé Sébastien Cabot) ; il accoste sur la rive du Río de Solís et y entend de la bouche d'indigènes plus amènes la fabuleuse histoire de la
Sierra de Plata, la Montagne d'Argent sur laquelle règne le fameux Rey Blanco susmentionné. Caboto bien évidemment s'enthousiasme et décide de remonter l'estuaire, puis le fleuve Paraná, à la recherche du fabuleux royaume... Arrivé à quelques 60km au nord de l'actuelle
Rosario, il débarque et fonde le fort de
Sancti Spiritu. Puis, découragé ou désireux de revenir plus tard, il rebrousse chemin. Mais la légende est née ; plusieurs aventuriers tenteront de remonter le Paraná, sans jamais atteindre la terre promise argentifère – que l'on identifiera plus tard avec le
Potosí bolivien ; entretemps, celui-ci aura été atteint depuis le Pacifique. Cependant, l'estuaire merveilleux y aura gagné son nom de Río de la Plata – le Fleuve de l'Argent.
Du Río de la Plata à l'Argentine
Référence commode dans la monotone géographie locale, l'estuaire donna rapidement son nom à la contrée environnante. Avant de devenir l'Argentine, celle-ci fut donc appelée Río de la Plata et les découpages administratifs successifs conservèrent cette appellation : en 1776 fut fondé le Vice-Royaume du Río de la Plata (détaché du Vice-Royaume du Pérou), et en 1816 la nation nouvellement indépendante se baptisa Provincias Unidas del Río de la Plata. Cependant, à partir de 1835, nouvelle constitution et nouveau nom : la Confederación Argentina voit le jour. D'où vient ce néologisme inattendu, qui sera ensuite perpétué par la República Argentina à partir de 1861 ?
Pour nous francophones, le rapport entre le pays et le métal (et donc l'estuaire) est évident ; mais pour les hispanophones, rien dans le nom de l'Argentine n'évoque immédiatement la notion d'argent. Car en espagnol, l'argent se dit plata, et la racine latine argentum n'a enfanté aucun vocable notoire. De nos jours, toutefois, l'étymologie d'Argentina est connue de tout Argentin qui se respecte. Elle est due au clerc espagnol Martín del Barco Centenera (1535-1605), qui s'installa sur les rives du Río de la Plata en 1573.
Le clerc est latiniste, et poète à ses heures perdues. Visiblement tombé sous le charme du Fleuve de l'Argent, il décide d'écrire un poème épique retraçant l'histoire de sa terre d'adoption et l'intitule “Conquista del Río de la Plata con otros acaecimientos de los reinos del Perú, Tucumán y el Estado del Brasil”. Visiblement dubitatif comme nous devant la lourdeur de ce titre encombrant, il imagine alors de lui substituer une exergue poétique et novatrice, savamment trouvée et soigneusement ampoulée. Se remémorant ses classes de latin, il transforme le “Río de la Plata” en “Fluvius Argentum” puis, tout de même désireux de populariser son œuvre, il invente le toponyme espagnol “La Argentina” et publie son pavé en 1601. Si d'aucuns chercheurs tatillons signalent que le mot “argentina” était déjà employé en 1587, il n'en demeure pas moins que c'est bel et bien Martín del Barco Centenera qui en popularisa l'usage jusqu'à ce qu'il s'impose au XIXème siècle.
Argentino y Rioplatense
Malgré tout, l'adjectif
argentino/a généra quelques réticences. Par exemple, Sarmiento en personne, avant de devenir la chantre de la Nation Argentine positiviste et triomphante, considérait dans sa jeunesse que le terme était par trop associé aux rives du Río de la Plata et ne pouvait s'appliquer au Sanjuanino qu'il était. Peu à peu cependant, le gentilé “Argentin” a fini par s'imposer et personne aujourd'hui n'oserait le remettre en question – sauf peut-être les
peuples originaires ?
Cependant, le Río de la Plata n'a pas totalement disparu dans la représentation culturelle sudaméricaine, et on désigne toujours du nom de
rioplatense les riverains des deux rives de l'estuaire : habitants de Buenos Aires, de La Plata, de Montevideo et de leur arrière-pays. Le terme même continue de désigner la vaste ère culturelle transfrontalière recouvrant le bassin du Río de la Plata et incluant le sud-est bolivien, l'Orient paraguayen, l'Uruguay et le nord argentin – terre
criolla de
gauchos et de
yerba mate.
Les fiches thématiques sans ancrage local particulier ne sont pas épinglées sur la carte.


 Cette fiche n'est pas dans
Cette fiche n'est pas dans

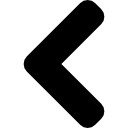
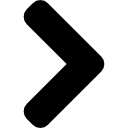
 photo 2/12 – Rive sud du Río de la Plata : la ville de Buenos Aires et les gratte-ciels de Puerto Madero
photo 2/12 – Rive sud du Río de la Plata : la ville de Buenos Aires et les gratte-ciels de Puerto Madero

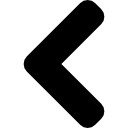
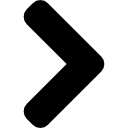
 photo 3/12 – Le “Fleuve de l'Argent” vu depuis l'avenue Costanera Rafael Obligado, à la sortie de l'aéroport domestique (BsAs)
photo 3/12 – Le “Fleuve de l'Argent” vu depuis l'avenue Costanera Rafael Obligado, à la sortie de l'aéroport domestique (BsAs)

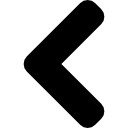
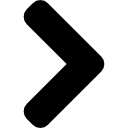
 photo 4/12 – Rive sud encore : le port de Buenos Aires vu depuis la réserve naturelle de la Costanera Sur
photo 4/12 – Rive sud encore : le port de Buenos Aires vu depuis la réserve naturelle de la Costanera Sur

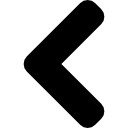
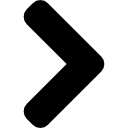
 photo 5/12 – Rive sud toujours : la jetée des pêcheurs, à Buenos Aires
photo 5/12 – Rive sud toujours : la jetée des pêcheurs, à Buenos Aires
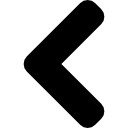
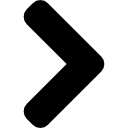
 photo 6/12 – Au sud de Buenos Aires, dans le quartier de La Boca, le Riachuelo se jette dans le Río de la Plata
photo 6/12 – Au sud de Buenos Aires, dans le quartier de La Boca, le Riachuelo se jette dans le Río de la Plata
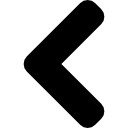
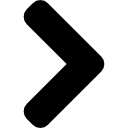
 photo 7/12 – Rive nord du Río de la Plata : la petite ville uruguayenne de Colonia del Sacramento
photo 7/12 – Rive nord du Río de la Plata : la petite ville uruguayenne de Colonia del Sacramento
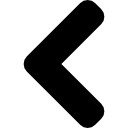
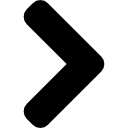
 photo 8/12 – A Colonia del Sacramento, un ferry achève la traversée du Río de la Plata en provenance de Buenos Aires
photo 8/12 – A Colonia del Sacramento, un ferry achève la traversée du Río de la Plata en provenance de Buenos Aires
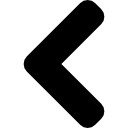
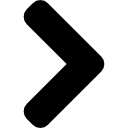
 photo 9/12 – Coucher de soleil sur le Río de la Plata, à Colonia del Sacramento (Uruguay)
photo 9/12 – Coucher de soleil sur le Río de la Plata, à Colonia del Sacramento (Uruguay)
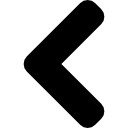
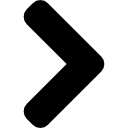
 photo 10/12 – Montevideo, capitale de l'Uruguay et principale ville sur la rive nord du Río de la Plata
photo 10/12 – Montevideo, capitale de l'Uruguay et principale ville sur la rive nord du Río de la Plata
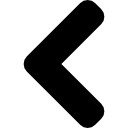
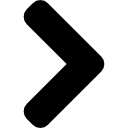
 photo 11/12 – La station balnéaire de Punta del Este (Uruguay), extrémité nord de la limite orientale du Río de la Plata
photo 11/12 – La station balnéaire de Punta del Este (Uruguay), extrémité nord de la limite orientale du Río de la Plata
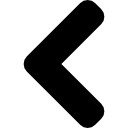
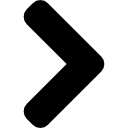
 photo 12/12 – La réserve naturelle de Punta Rasa, extrémité sud de la limite orientale du Río de la Plata
photo 12/12 – La réserve naturelle de Punta Rasa, extrémité sud de la limite orientale du Río de la Plata



 Capital Federal
Capital Federal Litoral
Litoral Metropolitana
Metropolitana
 Quelques précisions
Quelques précisions Provinces
Provinces Confins
Confins Carnets
Carnets Réserves
Réserves Héritages
Héritages Dévotions
Dévotions Archéologie
Archéologie Massifs
Massifs Vallées
Vallées Écosystèmes
Écosystèmes Botanique
Botanique Zoologie
Zoologie Ornithologie
Ornithologie Pasos
Pasos Cuestas
Cuestas H2O
H2O Gastronomie
Gastronomie Temples
Temples Mines
Mines Industrie
Industrie Trek & Cie.
Trek & Cie. Parcours
Parcours Musées
Musées Thermes
Thermes Villes
Villes Photos
Photos

 bientôt disponible
bientôt disponible